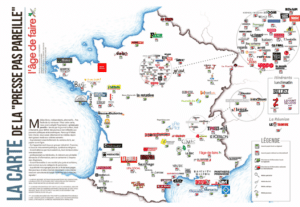Avec l’arrivée de logiciels d’intelligences artificielles, hautement performants et accessibles à presque tous, un nouveau style de média fait son apparition. En utilisant des programmes tels que ChatGPT, ces médias nouvelle générationparviennent à produirela grande majorité de leurs contenus (si ce n’est l’entièreté).
Le journalisme artificiel : définition
Le journalisme est l’un des métiers qui change et se réinvente le plus. La raison ? Il est intrinsèquement lié à la société dans laquelle il évolue. Périodiques, gazettes, ondes radios, journaux télévisés, sites web, aujourd’hui réseaux sociaux… Les médias d’informations se placent partout où se trouvent les auditeurs. Il ajoute des ramifications à ses compétences à pratiquement chaque décennie. Mais aujourd’hui, un nouveau type de “journalisme” (non reconnu par le métier) fait son apparition et en inquiète plus d’un: le journalisme artificiel.
Il se définit par l’utilisation quasi–exclusive de logiciels d’intelligence artificielle. Que ce soit pour la rédaction de contenus, le montage (voir la réalisation) de vidéos, la recherche ou la création de visuels pour habiller les papiers… L’intelligence artificielle est utilisée pour absolument tout, bien que les rendus finaux soient supervisés et relus par un être humain. Seulement, voilà ce qui inquiète les journalistes : ces intelligences artificielles savent-elles respecter la déontologie journalistique ? Autre sujet d’inquiétude : quels emplois restera-t-il pour les journalistes humains, si la technologie (moins chère, et plus rapide) les remplace au sein des rédactions ?
Blois Capitale : le premier média du genre
Il s’agit du premier site web, se revendiquant comme un site d’informations journalistiques, à utiliser l’intelligence artificielle pour produire l’intégralité de ses contenus. C’est bien simple, Marc Alvarez son créateur (aussi à l’origine du média en ligneCanal-supporters.com) opère entièrement seul. Ses employés et ses collègues ? Les logiciels d’intelligence artificielle. Il surfe sur la vague d’un nouveau type de production, rapide (une quinzaine d’articlesécris et publiés par jour), optimisé pour le web, et spécialisédans tous les domaines (vidéo, écriture, photo, mise en ligne et mise en page…).
Bien entendu, ces machines ne sont pas laissées à elles-mêmes. Lors d’une interview en compagnie de Magcentre, Marc Alvarez affirme se servir de ChatGPT et compagnie comme de simples outils, “comme une calculatrice”. Il repasse derrière pour une relecture et vérifie les informations. Pour le moment, le site est 100% gratuit et dénué de publicité. Seulement voilà : bien que les articles publiés sur le site soient vérifiés par leur propriétaire, peut-on se fier totalement à l’intelligence artificielle ? Est-elle réellement à même de remplacer complétement une véritable expertise journalistique ? Cette question inquiète la profession autant que les lecteurs.
Journalisme artificiel, qu’en pensent les journalistes professionnels ?
Sans grande surprise, le journalisme artificiel ne plaît pas, mais alors pas du tout à la profession. Pour des raisons aussi diverses que variées.
La qualité narrative et rédactionnelle des écrits: les IA sauront-elles vraiment imiter la plume humaine ? Ou de faire mieux ? L’écriture journalistique possède ses propres caractéristiques, il est autant question de rythme que de pertinence et de style.
La vérification des informations : étant basée sur les contenus fournis aux intelligences artificielles (par qui, ce n’est pas toujours très clair), ou sur ce que ces logiciels peuvent trouver sur Internet, comment vérifier la véracité des propos tenus ? Est-ce qu’une intelligence artificielle peut réellement mener une enquête sourcée, vérifiée et appuyée de sources solides ?
Les délais : s’il est vrai qu’une intelligence artificielle produit les contenus plus rapidement qu’un être humain, elle est aussi limitée dans les informations qu’elle possède. En effet, elle n’a accès aux actualités qu’à travers ce qu’elle peut accumuler sur le web. Une IA ne pourra donc pas reporter un évènement en direct, se rendre sur le terrain pour récolter des citations à chaud, ou prendre la température du public. L’exemple de ChatGPT est l’un des plus parlant : à ses débuts, le logiciel n’était capable de traiter que les informations ne datant que de 2021, grand maximum. Si elle peut désormais effectuer ses propres recherches sur Internet, le problème reste le même : il lui sera impossible de traiter d’un évènement qui a eu lieu au coin de la rue avant qu’il ne soit reporté sur Internet (qui comporte son lot non négligeable de fake news).
Le remplacement total des employés humains : en effet, il n’est jamais plaisant d’être mis à la porte par une machine. Ça vaut dans tous les corps de métiers, mais tout particulièrement dans ceux qui sont aussi proches du public que le journalisme. En 2013, Oxford a d’ailleurs publié une étude plus qu’inquiétante : sur 702 métiers analysés, environ 47% d’entre eux étaient susceptibles d’être automatisables d’ici une vingtaine d’années. Et ça, c’était bien avant l’apparition de logiciels aussi performants et pratiquement autonomes que l’on trouve aujourd’hui (dont certains en libre accès).
Le respect de la déontologie journalistique : voilà le point que tient le plus à cœur aux professionnels et aux lecteurs. Si le journalisme a su gagner la reconnaissance et la confiance du public, c’est bien grâce à sa déontologie. Régie par une charte perfectionnée au fil du temps, et certifiée par la carte de presse, c’est grâce au respect cette déontologie que l’on peut appeler journalisme ou non une enquête, un reportage, ou un portrait. Même si une intelligence artificielle est capable d’en assimiler les règles, saura-t-elle la mettre en pratique ? Pire, les personnes détenant ces nouveaux médias artificiels s’obligeront-elles à respecter cette déontologie ou privilégieront-ils le profit ?
Et l’ISFJ dans tout ça ?
En tant que formatrice des journalistes de demain que représentent ses étudiants, il est important pour l’école de s’interroger sur ces questions. Mieux encore : elle considère comme primordial d’y faire réfléchir très sérieusement les étudiants au sein de leur cursus d’apprentissage.